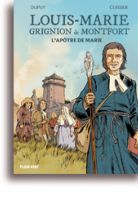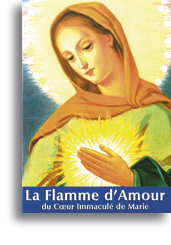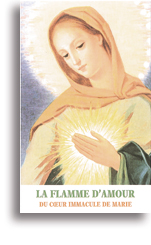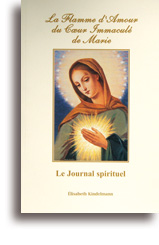Elisabeth Kindelmann Journal spirituel
La Flamme d’Amour - Hongrie
Le Journal spirituel d’Elisabeth Kindelmann – l’âme privilégiée qui a reçu de Jésus, de Marie et d’un ange les confidences du Ciel – paraît actuellement aux Editions du Parvis. Elisabeth Kindelmann est connue partout dans le monde pour avoir répandu la dévotion à la Flamme d’Amour. Son journal spirituel a reçu l’imprimatur1 du cardinal Péter Erdö, primat de Hongrie et archevêque de Esztergom-Budapest. Nous souhaitons vous faire découvrir la vie très dure et extraordinaire de la messagère de la Flamme d’Amour. Voici la biographie qui la présente en début du livre que vous pouvez vous procurer à la Librairie du Parvis.
Elisabeth Kindelmann, née Szántó, a vu le jour à l’hôpital Saint-Etienne, à Kispest, en Hongrie, le 6 juin 1913. Elle est baptisée le 13 juin 1913.
Dans les écrits posthumes de son directeur spirituel, mort en 1976, nous apprenons qu’elle était issue d’une famille pauvre. Ses parents sont Joseph Szántó, imprimeur (1871-1917), et Ersébet Meszaros (1878-1924). Son père est protestant, sa mère catholique. Les enfants reçurent une éducation catholique. Elisabeth eut douze frères et sœurs, six fois des jumeaux. Elle seule, qui était la treizième enfant, n’était pas jumelle. Et elle seule a atteint l’âge adulte. Sept de ses frères et sœurs furent victimes de la grippe espagnole de 1919. Deux sont morts des suites de la diphtérie et deux accidentellement. Un autre de ses frères est mort jeune; Elisabeth ne connaît pas la raison du décès. «Après le décès de mon père, soit de 1917 à 1919, je fus élevée, dit-elle, par mes grands-parents maternels à Seresznyéspuszta, car à cause de ma santé fragile, le médecin me conseilla de vivre à la campagne. De cette période, je ne me souviens pas qu’on m’ait amenée à l’église de Szekazard, à quatorze kilomètres de là. Je me souviens seulement que ma grand-mère portait toujours un chapelet, enroulé autour de son poignet, même quand elle allait nourrir les poules et les porcs. De septembre 1919 à juin 1923, je suivis l’école élémentaire de jeunes filles de la rue Pannonia à Budapest.»
Dès le 8 novembre 1923, dans le cadre d’une action internationale, Elisabeth fut envoyée en Suisse, dans la famille d’un riche fabricant de machines agricoles à Willisau. «De l’enfant chétive que j’avais été, dit-elle, je suis devenue, sous la surveillance de gouvernantes françaises et allemandes, une jeune fille, passant de vingt et un à trente-huit kilos.
En novembre 1924, je suis rentrée à Budapest, en réalité par amour pour ma mère qui était gravement malade et ne quittait plus le lit. A la fin de 1924, mes «parents» de Willisau voulaient m’adopter et m’amener définitivement en Suisse. Le rendez-vous était fixé pour dix heures à la gare de Graz (Autriche). Je suis arrivée à dix heures du soir, et eux m’attendaient à dix heures du matin. C’est ce malentendu fatal qui fit que je dus accomplir ma mission en Hongrie. Un jeune couple hongrois me ramena à Budapest.
A l’âge de douze ans, je travaillai dans le ménage de mon oncle maternel à Vajta, de Pâques jusqu’à la récolte du maïs, mais je ne pouvais supporter la paresse de mes trois cousins et de ma cousine, et je les quittai sans un mot pour rentrer à Budapest.
De novembre 1925 à juin 1926, je me suis engagée comme domestique chez la mère d’un notable de province. Je devais travailler du matin au soir et ne recevais qu’un seul repas par jour. Je vivais dans une situation sociale pitoyable et souffrais de la faim. Aussi, je pris mon bagage et partis en direction du centre-ville. Sous la porte cochère d’une petite maison délabrée, j’aperçus une vieille dame pas très sympathique ayant un siphon d’eau de Seltz vide dans la main. Elle me regardait et m’appela; elle me demanda de lui acheter une bouteille d’eau de Seltz au bistro d’en face. Elle me donna l’argent et regarda si je faisais ce qu’elle avait dit. Je lui apportai l’eau de Seltz et elle me questionna, puis je montai chez elle et elle m’offrit un petit-déjeuner. Elle m’engagea pour cultiver son petit jardin pour la contre-valeur des repas.
Il y avait là des visiteurs étranges. En criant, je résistai physiquement à un jeune homme qui fréquentait la maison. Le jour même, je m’en allai, continuant à errer avec mon petit bagage. Ce jour-là, le 10 août 1926, je me rendis à l’église de l’Adoration perpétuelle de l’avenue Ülloi. Lorsqu’on ferma l’église, j’errai avant d’aboutir sur un banc de la place Matyas. L’agent de police qui faisait sa ronde eut pitié de moi et ne me chassa pas. Quand le jour se leva, je me rendis à l’église du Cœur de Jésus, où je dormis pendant toute la messe. Après m’être réchauffée, je recommençai à errer pour trouver du travail. A côté de l’église de Jozsefvaros, sur la porte d’une crèmerie, j’ai lu qu’on engageait des porteurs de lait. Je me suis présentée et on m’engagea, mais on me dit que je ne pourrais prendre le travail que trois jours plus tard, quand l’ancien porteur aurait quitté la crèmerie. Que faire durant ces trois jours? Il y avait, rue Koszuru, une manufacture qui engageait tout de suite des personnes qui s’occupaient à casser des noix. Les employés étaient assis le long d’une table. Chacun avait deux paniers. Ils prenaient les noix dans un panier, les cassaient, et mettaient les noix écalées dans l’autre. La production de chacun était pesée. On payait quatre fillers par heure et, pour dix fillers, je pouvais acheter cinq croissants au marché de la place Teleki, le moins cher de la ville. Je suis allée chez les pères franciscains qui m’ont donné un peu d’argent. J’ai partagé le pain avec une femme affamée. Nous le mangeâmes tout de suite sur un banc de la place. Les franciscains m’ont proposé de m’adresser aux sœurs de la rue Maria, qui m’ont effectivement donné asile pour un pengo. La faim me poussa à voler et j’eus honte. Je suis allée me confesser. Le père qui me confessait pleurait avec moi et me rassurait que je n’avais pas commis de péché, car c’était la misère qui m’avait contrainte à voler. Plus tard, les sœurs chez qui j’étais logée me firent grâce du prix de l’hébergement.
Dans ma misère et sans aucun appui humain, je dus changer d’employeur pour chaque sou de plus. Pour un même travail dans une crèmerie de la rue Baross (huitième arrondissement de Budapest) on me donnait six pengos, ainsi que le déjeuner. La troisième crèmerie, également rue Baross, assura mon existence pendant près d’un an. C’était ce travail qui était le plus favorable du point de vue matériel. Je gagnais huit pengos et je ne travaillais que de cinq heures et demie à onze heures. Je passais mes heures libres à prier, le plus souvent à l’église de l’Adoration perpétuelle. Je participais régulièrement à l’office de l’Adoration perpétuelle. Pour compléter mon salaire, je me suis engagée dans une usine où l’on épluchait des pommes de terre. On payait deux fillers pour dix kilos de pommes de terre épluchées. En trois heures, je pouvais gagner douze fillers. Parallèlement, je vendais des friandises dans un petit cinéma de banlieue. Je ne regardais pas les films. Pendant la séance, assise dans un fauteuil vide, je pensais à Dieu. La directrice m’emprunta souvent de petites sommes. Quand ses dettes s’élevèrent à vingt pengos, elle préféra se débarrasser de moi. Elle me renvoya.
Je devins porteuse occasionnelle aux Halles du neuvième arrondissement. A six heures, j’allais aux Halles et proposais mes services aux dames venues faire leurs achats. Arrivée chez elles, plus d’une de ces femmes m’invitaient à prendre le petit-déjeuner. C’est ainsi que je fis la connaissance d’une famille bourgeoise de Budapest, grâce à laquelle je pus fréquenter des cours à l’école d’infirmière de la rue Dohany, dans le huitième arrondissement. Ce ne sera pourtant qu’une dizaine d’années plus tard que je pourrai mettre en pratique mes connaissances d’infirmière à l’hôpital des sœurs franciscaines et à l’hôpital antituberculeux de l’avenue Tarogato. Je poursuivis cette occupation aux Halles même quand j’eus un emploi dans une petite entreprise familiale de brosserie. Mon salaire s’élevait à soixante pengos par mois et la famille m’offrait le déjeuner. J’avais ainsi les moyens de louer une chambre et je m’installai au 10 de la rue Magdolna, au premier étage, où je payais vingt pengos par mois. Je travaillais de huit à seize heures.
Dans ce combat pour le pain quotidien, je désirais faire connaître le Bon Dieu aux gens. Je fus sans cesse préoccupée par la nécessité de l’enseignement religieux et de la mission. A l’âge de quinze ans, j’ai décidé de devenir religieuse de l’Adoration perpétuelle (la Congrégation des religieuses réparatrices fut fondée à Paris par la comtesse d’Oultremont). Je passai des heures à regarder, silencieuse, le Saint-Sacrement exposé à l’adoration des fidèles. Ainsi, mon cœur se remplissait de l’amour de Dieu.
Un jour, j’ai décidé de me rendre au couvent et de demander à la sœur portière comment on pouvait être admis. Elle me répondit qu’il fallait une recommandation et me remit une grande feuille imprimée sur laquelle on énumérait ce qu’il fallait remettre au couvent lors de l’admission. En plus de la longue énumération des éléments du “trousseau”, il était indiqué que chacun pouvait verser une certaine somme, suivant ses possibilités. Je lus tout cela avec stupéfaction et je pensai que je ne pourrais jamais amasser une telle fortune. Ma pauvreté fit donc échouer mes projets de devenir religieuse. Pourtant, le désir de devenir religieuse missionnaire naissait et grandissait dans mon âme. Je ne me doutais pas encore que Dieu avait d’autres projets avec moi.»
Automne 1928. «Je ne me rappelle plus du tout le nom de la dame âgée que je rencontrai souvent à l’Adoration perpétuelle. Je lui fis part de mes projets et de mes rêves de missionnaire. Elle me donna l’adresse des sœurs missionnaires de la rue Hermina, qui éduquaient des orphelins et qui déléguaient aussi des missionnaires. Arrivée à la rue Hermina, je demandai à parler avec la sœur chargée des admissions. C’est là que pour la première fois de ma vie j’entendis l’expression “supérieure”. La sœur portière me fit entrer dans la chambre d’hôtes. La supérieure arriva et me fit asseoir, car j’étais restée debout par habitude. Je lui ai dit mon intention d’aller en mission pour faire connaître aux gens le Bon Dieu. Après lui avoir raconté que j’étais orpheline et lui avoir dit ce que je gagnais, se levant, elle me dit: “Sais-tu, mon enfant, pourquoi tu veux devenir religieuse? Tu n’as pas la vocation, seulement tu es orpheline, tu n’as pas un foyer, et c’est pour cela que tu veux entrer au couvent.” Sur cela, la conversation fut interrompue. Tout s’ébranla en moi. Je n’ai raconté mon échec à personne, sauf à la dame qui m’avait fourni l’adresse de ce couvent. Après m’avoir écoutée, elle me dit: “Va à la maison mère de l’avenue Ménesi, chez la supérieure provinciale.” Je pris le tramway pour aller à Pest (Buda et Pest sont séparées par le Danube qui coupe la ville en deux) par le pont François-Joseph. Je demandai à voir la supérieure provinciale. Je dus attendre quelques cinq minutes, qui me parurent aussi longues que les cinq minutes qui précéderont ma mort.
La supérieure provinciale me parla avec tant de gentillesse que je fus complètement détendue. Je lui racontai tout avec une complète sincérité. Elle me prit la main comme une mère et me dit: “Nous demanderons au Seigneur Jésus quelle est sa volonté, et Il nous dira ce que nous devons faire. Tout se passera selon sa volonté.” Nous entrâmes toutes les deux dans la chapelle, mais moi je suis restée en arrière, debout auprès des bancs. Je regardais de loin comment la supérieure provinciale parlait avec le Seigneur Jésus. Avec une douce légèreté, la supérieure revint à moi, me prit la main et me ramena dans la salle de réception. Là, elle me fit asseoir, posa sa main sur la mienne, me regarda très très profondément dans les yeux, et me dit: “Mon enfant, la volonté de Dieu est différente.” J’eus presque un malaise. “Sais-tu quelle est la volonté du Bon Dieu? Il veut autre chose de toi. Il te confiera une autre mission. Cette mission que Dieu te confiera, remplis-la aussi bien que tu pourras.” La supérieure provinciale m’accompagna jusqu’à la sortie. Elle m’embrassa sur le front et me bénit. La volonté de Dieu était autre. Après la rencontre avec la Supérieure provinciale, tout s’était écroulé en moi. J’étais désemparée. Cette torture de mon âme dura une semaine. Alors je ne savais pas encore que ce supplice était l’œuvre du diable.
Après une confession chez le Père Matray (qui devint par la suite mon confesseur pour de longues années), l’obscurité de l’incertitude se dissipa dans mon cœur.»
1927-1930. «Prier et connaître, je n’avais pas d’autre désir. J’ai du mal à exprimer la soif que j’avais d’étudier pour élargir mes connaissances. En six mois, j’ai appris mot à mot les manuels des deux premières années de l’école primaire supérieure. Mais je n’avais pas l’argent pour passer les examens. Je me suis mise à étudier les livres des troisième et quatrième années. J’ai ainsi fait mes études sans avoir de certificat. L’automne 1929 apporta un grand tournant dans ma vie. Comme j’avais une belle voix et une oreille fine, je fus admise au chœur de l’église de la Communauté du Christ-Roi à Jozsefvaros (huitième arrondissement). Le premier ténor était Karoly Kindelmann, tandis que j’étais le premier soprano. Il demanda à m’épouser. Je me suis mariée à l’âge de seize ans. Mon mari en avait trente de plus. Il exerçait le métier de maître-ramoneur, ce qui payait bien à l’époque. Notre mariage eut lieu le 25 mai 1930, dimanche de la Pentecôte. Mon mari fit construire une maison de quatre pièces dans la périphérie de Budapest. De 1931 à 1942 naquirent six enfants. L’Angélus et le Rosaire faisaient partie de notre vie quotidienne.
Le 26 avril 1946, mon mari décédait. Mon état de veuve avec six enfants était particulièrement lourd. Après la dévastation de la guerre, je ne pus survivre avec mes enfants qu’en troquant nos biens. Les armoires se vidaient et presque toutes nos affaires changèrent de propriétaire. La nationalisation de 1948 amena ma famille au bord du goufre. Je devins serveuse à l’académie militaire, où je travaillais douze heures par jour. Les restes qui n’étaient pas consommés assuraient les repas de ma famille. Mais six mois plus tard, j’étais renvoyée pour des motifs “politiques”. On avait constaté que je gardais chez moi une statue de la Vierge et des chandelles.»
Novembre 1950 - mai 1951. «J’étais dans une situation humainement sans issue. Les problèmes pécuniaires presque insoutenables m’éloignaient de plus en plus de Dieu. Je déambulais sans but précis de rue en rue, de quartier en quartier. C’est ainsi que je vis, dans le quartier de Kobanya, que l’enseigne de l’ancienne fonderie Eötli avait changé, s’appelant maintenant fonderie Gábor Aron. Un chef du personnel de bonne volonté m’y engagea comme contrôleur technique des pièces. Ainsi, je pus sauver ma famille de la famine. Mes enfants faisaient un travail d’artisanat à domicile. Mes deux filles aînées confectionnaient des bas avec une machine à tricoter, tandis que les garçons fabriquaient de la toile à tamis sur un métier à tisser. Peu après, l’usine où je travaillais fut réorganisée, ce qui entraîna le renvoi d’un certain nombre d’employés, dont je faisais partie. Je dus recommencer à chercher du travail. Le 26 décembre 1951, ma fille aînée, Cécile, se marie. En lisant une annonce dans un journal, j’ai trouvé du travail dans une usine de cuisinières. Le salaire y était tellement bas que je dus bientôt chercher un autre emploi. En automne 1953, je devins employée à la fabrique d’appareils de gaz. Mon emploi prit fin un mois avant le soulèvement national de 1956.»
Noël 1955. «Ma deuxième fille, Valérie, se marie.»
Eté 1957. «Mon employeur suivant est le teinturier Lazlo Harangi, dans le septième arrondissement. Après la teinturerie, je fus occupée dans une coopérative artisanale où je fabriquais des écharpes de soie.»
Juin 1957. «Mariage de ma troisième fille, Maria. En juin 1958, c’est mon fils, Karoly, qui se marie.
En 1959, le problème du logement des quatre nouvelles familles est résolu.»
1960. Les soucis matériels ayant presque disparu, Elisabeth Kindelmann va s’inscrire à l’université populaire pour y étudier la psychologie et l’astronomie. Pourtant, ce projet, comme tant d’autres, échoua. «Le 13 juillet 1960, trois jours avant la fête de Notre-Dame du Carmel, j’eus une merveilleuse illumination spirituelle, écrit-elle. Cette illumination dura trois jours, du lever jusqu’au soir. Dès que je parlais à quelqu’un ou que quelqu’un me parlait, cette illumination cessait. Cette douce sensation créait en moi un calme serein. C’était une expérience qui surpassait tout. Ce n’est que plusieurs semaines plus tard que je sus que cette illumination constitua l’introduction muette de la présence du Seigneur qui ne peut être exprimée en termes intellectuels.»
Noël 1961. Jozsef, deuxième enfant, mais premier des trois fils, se marie à l’âge de vingt-six ans. En six ans, cette famille eut trois fils. Leur mère mourut après la naissance du troisième enfant, à la suite d’un cancer du sein. La grand-mère paternelle se chargea d’élever les trois petits orphelins. Lorsqu’elle approcha la cinquantaine, elle crut qu’une période calme et paisible succéderait à une vie mouvementée. Mais voici que le Seigneur et sa sainte Mère s’adressent à elle.
1962. «Avant de recevoir les messages de Jésus et de la Sainte Vierge, je reçus l’appel suivant: “Renonce à toi-même, car Nous te confierons une grande mission. Mais tu ne seras de taille à l’accomplir que si tu renonces complètement à toi-même. Tu as le libre arbitre. Tu ne devras donc accomplir cette mission que si tu le veux toi aussi.” Après les doutes et les tourments de mon âme, j’acceptai la volonté de Dieu. Mon âme fut tellement envahie de grâce que je ne pus dire un mot.»
C’est en son for intérieur qu’elle entend leurs paroles. Elle distingue clairement la voix du Seigneur Jésus, de la Vierge Marie, ou de l’ange.
Le 11 avril 1985, Elisabeth Kindelmann est décédée à la suite d’une longue maladie supportée avec patience et réconfortée par le sacrement des malades. Elle a été ensevelie à Erd-Ofalu, à environ vingt-quatre kilomètres au sud-ouest de Budapest, au bord du Danube. Avant de servir comme instrument au Seigneur et à la Vierge Marie, elle dut endurer des épreuves innombrables qu’elle surmonta avec une rare énergie. Pendant de nombreuses années, son identité demeura inconnue.
Elisabeth Kindelmann,
«La Flamme d’Amour du Cœur Immaculée de Marie –
Le Journal spirituel»
Note:
1. Le 6 juin 2009, le texte original hongrois du Journal spirituel d’Elisabeth Kindelmann a obtenu l’imprimatur numéro 494-4/2009 du cardinal Péter Erdö, archevêque de Esztergom-Budapest et primat de Hongrie.